Depuis l’Antiquité, la transmission des savoirs oscille entre dialectique, didactique et rhétorique. Avec l’essor des technologies d’intelligence artificielle générative (Natural Language Generation (NLP)), de nouvelles interrogations émergent sur le statut du savoir et de la vérité dans l’éducation. Ces systèmes d’IA, en tant que technologies de production du langage, relèvent-ils davantage de la rhétorique que de la didactique ? Quels en sont les impacts pédagogiques et éthiques ? Cet article propose d’analyser comment la dialectique socratique peut servir de cadre pour encadrer leur usage dans l’enseignement.
La dialectique socratique et la critique de la rhétorique sophistique
À travers les dialogues platoniciens tels que Gorgias[1] et Protagoras[2], Socrate s’oppose aux sophistes qui enseignaient la rhétorique comme art de la persuasion, indépendamment de la vérité. Pour lui, la dialectique est un chemin vers le savoir véritable, alors que la rhétorique sophistique est un instrument de manipulation. Dans Gorgias, Socrate distingue la rhétorique de la véritable connaissance : la première produit des discours séduisants mais sans fondement, alors que la seconde exige un examen critique des idées. Dans Protagoras, il remet en cause l’idée que la vertu puisse s’enseigner comme un simple savoir technique.
En sciences de l’éducation, la dialectique socratique correspond aujourd’hui à une pédagogie active, fondée sur le questionnement et la co-construction du savoir. À l’opposé, la rhétorique sophistique évoque une approche où l’élève est simplement réceptif à un discours bien construit sans exercice de pensée critique. La dialectique favorise ainsi une éducation émancipatrice, tandis que la rhétorique, lorsqu’elle est purement persuasive, peut devenir un outil de domination intellectuelle.
L’IA générative du langage : une technologie rhétorique, non didactique
Les modèles d’IA générative du langage fonctionnent sans intentionnalité ni référent ontologique : ils produisent du texte en fonction des probabilités statistiques de mots les plus susceptibles de suivre dans une séquence. Contrairement à la dialectique socratique et à la didactique, qui visent l’acquisition d’un savoir structuré et critique, l’IA génère du texte qui paraît convaincant mais ne garantit ni cohérence ni véracité.
Ce phénomène rappelle les critiques de Platon envers les sophistes. L’IA persuade sans instruire. Elle renforce les opinions préexistantes sans remise en question. Elle peut être manipulée pour tromper et désinformer. Un parallèle peut être fait entre l’IA et Gorgias, le sophiste, qui ne transmet pas de connaissance mais apprend à persuader.
Implications pédagogiques et éthiques : comment encadrer l’IA en éducation ?
Si les enseignants utilisent des IA génératives sans discernement, l’éducation risque de devenir une simple transmission de discours persuasifs, au détriment d’une formation à l’esprit critique. Ce risque est particulièrement préoccupant dans des domaines où la vérité factuelle est essentielle (sciences, histoire, droit, éthique…).
Toutefois, l’IA ne doit pas être rejetée mais intégrée dans une pédagogie dialectique favorisant l’interrogation critique. Il est possible de mettre en débat les réponses de l’IA en invitant les élèves à interroger, vérifier et contester les productions de l’IA, comme Socrate le faisait avec les discours sophistiques. Chacun doit apprendre à repérer la manipulation ; il s’agit toujours de former à une lecture critique des textes (générés par IA) pour détecter les biais et erreurs. Le pédagogue encadrera l’IA dans une démarche d’investigation. Par exemple, il utilisera l’IA comme point de départ, non comme une source ultime, en obligeant l’élève à croiser ses productions avec des sources fiables.
4. Vers une nouvelle didactique intégrant l’IA
L’IA pourrait être réorientée pour devenir un outil socratique, favorisant le questionnement plutôt que la persuasion aveugle. Elle pourrait être utilisée pour stimuler le débat en générant des réponses opposées sur un même sujet. Elle pourrait être utilisée pour provoquer des contradictions en confrontant ses propres erreurs à l’analyse humaine. Elle pourrait servir d’outil heuristique pour explorer différentes interprétations d’une question donnée.
Conclusion
L’émergence des IA génératives oblige à repenser la distinction entre rhétorique et didactique en éducation. L’IA, technologie rhétorique par nature, doit être encadrée par une pédagogie dialectique inspirée de Socrate pour éviter une nouvelle forme de sophistique. Il s’agit de :
- Former chaque personne – élèves, professeurs… – à l’esprit critique face aux productions de l’IA.
- Intégrer l’IA comme un outil de questionnement et non comme une source de vérité.
- Redonner à l’éducation son rôle socratique : éveiller l’intelligence plutôt qu’enseigner des discours prêts-à-consommer. Ainsi, en intégrant les principes de la dialectique socratique, l’éducation peut éviter le piège d’une manipulation rhétorique massive et former des citoyens capables de discerner le vrai du faux dans un monde où l’IA générative prolifère.
[1] Platon, Œuvres complètes. Tome 3, 2ème partie : Gorgias – Ménon, trad. par Maurice Croiset, Budé (Paris : Les belles Lettres, 1967).
[2] Platon, Protagoras, Budé 15 (Paris : Les Belles Lettres, 1935).

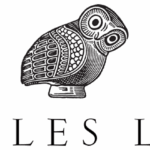

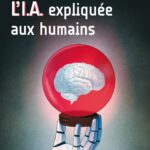
Laisser un commentaire